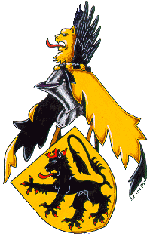08/06/2009
LA SOUVERAINETE DU PEUPLE EST UNE HERESIE
Doctrine des théologiens sur l'origine de la société et du pouvoir civil
‘Suffrage universel — Mensonge universel’ Pie IX
Quelle est l'origine de la société civile ?

Avant de répondre à cette question, il est nécessaire d'en bien préciser le sens, car l'origine de la société peut être considérée au point de vue de l'histoire ou au point de vue de la doctrine.
C'est à la philosophie chrétienne, que nous demanderons d'abord de nous répondre et de nous dire pour quelles raisons il est nécessaire à l'homme de vivre en société.
L'homme, dit Saint-Thomas d'Aquin, ne peut se suffire à lui seul.
Comment un individu isolé pourrait-il se procurer tout ce qui est nécessaire à sa nourriture ? Comment se préparerait-il des vêtements, des remèdes, un abri ? Comment fabriquerait-il, en même temps, ses instruments de travail ?
Restant seul, il ne pourrait faire de son temps et de ses forces une part suffisante pour accorder à l'étude, au travail manuel et aux soins de sa nourriture ce qui est nécessaire, cependant, pour qu'un homme arrive au complet développement de ses forces physiques et de ses facultés morales.
Il est vrai que les philosophes du XVIII° siècle ont prétendu que cet état d'ignorance et d'isolement était l'état naturel de l'homme ; mais, par une contradiction singulière, ils avouaient que si l'humanité n'était sortie de cet état de nature, pour se constituer en sociétés, elle eût infailliblement péri.
Singulier état de nature, assurément, qui eût mené la nature humaine à sa destruction !
Cet aveu seul peut suffire à prouver la vérité de la thèse catholique : car l'état naturel d'une créature doit être favorable à sa conservation et au perfectionnement de ses facultés.
Or, cet état, qui favorise la conservation et l'amélioration de l'espèce humaine, c'est l'état social.
Le véritable état de nature est donc celui de l'homme vivant en société avec ses semblables.
Mais il y a plusieurs sortes de sociétés parmi les hommes.
La première, la plus naturelle, la plus nécessaire de toutes, c'est la famille, qui fournit à l'homme les premiers secours, et les plus indispensables, à la conservation et au bien-être de la vie.
C'est elle qui,par le mariage, assure la multiplication du genre humain sur la terre; c'est elle qui procure à l'enfance les soins multiples qu'exigent la délicatesse de son corps et l'ignorance de son esprit ; c'est elle qui donne les affections pures et fidèles.
Mais elle n'est pas la seule société nécessaire. Ce que nous avons dit de l'individu isolé peut, dans une certaine proportion, s'appliquer à la famille, si elle ne trouve dans une société plus étendue et plus forte le complément dont elle a besoin.
Elle aussi ne peut se suffire entièrement à elle-même.
Pourra-t-elle, par ses seules ressources, exercer les industries multiples que suppose un degré convenable d'aisance et de bien-être dans le vêtement, la nourriture et l'habitation ? Ses membres pourront-ils, à eux seuls, acquérir les connaissances nombreuses et difficiles que suppose l'exercice convenable de ces différentes industries ? Pourront-ils se livrer à l'étude des sciences, dans la mesure où elles sont nécessaires au développement normal de l'intelligence ? Enfin seront-ils en mesure de résister à leurs ennemis et de se faire justice eux-mêmes, sans blesser les droits d'autrui ?
Une famille isolée, placée en dehors de toute société, et n'ayant rien, qu'elle ne doive tirer de ses propres ressources, sera nécessairement dans une grande indigence des biens dont l'homme a besoin pour le développement de ses facultés.
Ainsi, les familles sont amenées par la nécessité à s'unir en une société plus parfaite, comme les individus sont poussés par une nécessité encore plus impérieuse à se grouper autour d'un foyer.
Cette société, appelée à suppléer à l'insuffisance de la société domestique et à assurer, en même temps, sa conservation et sa prospérité, dans l'ordre public, est désignée communément par les auteurs sous le nom de société civile ou société politique ; son origine, sa raison d'être, c'est la loi naturelle elle-même, c'est-à-dire Dieu, qui en est la règle et l'auteur.
C'est Dieu qui a fait l'homme, tel qu'il ne puisse vivre sans l'institution de la famille ; c'est donc Dieu qui est l'auteur de la famille. C'est Dieu, auteur de la famille qui a fait cette société première insuffisante par elle-même, en sorte que les familles aient une tendance naturelle à s'unir pour former la société civile ; Dieu est donc l'auteur de la société civile.
Ainsi, la cause première de la société civile, c'est Dieu ; sa cause prochaine, c'est la nature de l'homme, sa cause immédiate, c'est la nature de la famille.
Telle est, en quelques mots, la réponse de la philosophie catholique à notre question : Quelle est l'origine de la société civile ?
Interrogeons maintenant l'histoire. Il ne s'agit pas ici de remonter à l'origine de chaque société civile, de chaque nation, mais seulement à l'origine de la première société, de celle avant laquelle il n'existait que des familles.
L'histoire des origines de notre race est tout entière contenue dans les premiers chapitres dela Genèse ; les faits qu'elle rapporte sont attestés par l'autorité même de Dieu : il n'y en a donc pas qui puissent présenter un plus grand caractère de certitude.
Nous trouvons, dans ces faits, une confirmation éclatante de la doctrine formulée plus haut.
Au commencement, Dieu crée un seul homme, mais il ajoute bientôt : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il lui donne une compagne, « adjutorium simile sibi », et la famille est fondée.
L'homme pécha, avant que la famille eût pu donner naissance à une autre société ; faut-il en conclure que la société civile n'aurait pas existé si Adam eût persévéré dans l'état d'innocence ?
Ce serait trop se hâter de résoudre une question sur laquelle de grands théologiens ont des opinions contraires et qui, d'ailleurs, est indifférente.
En tout cas, il est de fait que la société civile, supposant la pluralité des familles, n'a pu se former et ne s'est formée, en réalité, qu'après une certaine propagation du genre humain sur la terre.
Toutefois, la formation de la société fut contemporaine des premiers hommes.La Genèse fait, pour la première fois, mention de la fondation d'une ville, après le meurtre d'Abel par son frère .
Caïn ne fut pas le seul fils d'Adam qui donnât naissance à une cité, et, avant la fin de sa longue carrière, le père de tous les hommes put voir des villes nombreuses et florissantes sortir de cette terre que Dieu lui avait donnée pour être fécondée par son travail.
Le fait primordial qui a déterminé la formation des anciennes sociétés politiques, c'est l'extension et la multiplication des familles issues d'une même souche, lui restant unies d'abord par des liens purement domestiques, puis, peu à peu, par des relations d'un caractère public et juridique.
Ensuite, la conquête, les traités ou le libre consentement de plusieurs, ont servi de point de départ à la formation d'un grand nombre d'États ; mais la communauté d'origine reste le fait naturel qui donne naissance aux cités. C'est ce que Cicéron exprimait ainsi : « Prima societas in ipso conjugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia omnia. Id autem est principium urbis et quasi seminarium reipublicae ». (De Officiis).
Ainsi, la philosophie et l'histoire s'accordent pour affirmer que la société est voulue et exigée par la nature, et que les théories du Contrat social ne sont pas moins en contradiction avec les faits qu'avec la raison.
Dans l'Encyclique « Immortale Dei » le Souverain Pontife a résumé la doctrine catholique : « L'homme, dit-il, est né pour vivre en société, car ne pouvant dans l'isolement ni se procurer ce qui est utile et nécessaire à la vie, ni acquérir la perfection de l'esprit et du coeur ;la Providence l'a fait pour s'unir à ses semblables en une société tant domestique que civile, seule capable de fournir ce qu'il faut à la perfection de l'existence ». Déjà, dans l'Encyclique « Diuturnum illud », le Pape avait dit plus brièvement encore et avec plus de force : « Magnus est error non videre, id quod manifestum est, homines, quum non sint solivagum genus, citra liberam ipsorum voluntatem ad naturalem communitatem esse natos » ; et, parlant du Contrat social, il ajoutait : « Ac praeterea, pactum quod praedicant, est aperte commentitium et fictum. »
L'enseignement de l'Église est donc très nettement formulé sur ce point, et les catholiques ne peuvent hésiter à le suivre.
II
Quelle est la nature et la fin de la société civile ou politique?
1° Nature de la société civile.
La société civile est une société naturelle, nécessaire, parfaite et organique. Elle est naturelle, ce qui ne veut pas seulement dire qu'elle est conforme à la nature de l'homme et que les principes de la raison naturelle suffisent, par eux-mêmes, à sa constitution et à son fonctionnement ; cela implique encore que ses lois fondamentales, sa constitution essentielle, sont dictées et imposées par la nature et qu'il n'est pas loisible à l'homme d'en méconnaître les principes et d'en violer les prescriptions.
De même que, pour la société domestique, l'unité et l'indissolubilité du lien conjugal sont imposées aux hommes par une volonté supérieure, de même, pour la société civile, il est des lois qui s'imposent au législateur lui-même, qu'il n'a pas le pouvoir d'enfreindre, mais qu'il a le devoir de reconnaître et de sanctionner.
Tous les droits et tous les devoirs, même dans l'ordre civil, ne dérivent donc pas de la loi humaine ; l'État n'en est pas l'auteur et la source ; mais il est des droits imprescriptibles dont il a le devoir de se faire le protecteur et le gardien. C'est pourquoi, la proposition suivante a été condamnée dans le Syllabus :
39. L'État, comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.
La société civile est, en second lieu, une société nécessaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement conforme et proportionnée à la nature de l'homme, mais que cette même nature exige qu'une telle société existe.
Ce qui a été dit précédemment sur l'origine de la société civile peut servir à prouver cette nécessité et à en expliquer la nature.
L'existence de la société civile est nécessaire au complet et parfait développement de l'espèce humaine ; elle n'est pas rigoureusement et directement exigée pour la conservation de chaque individu et de chaque famille considérée séparément
Nous verrons combien cette remarque est importante quand nous traiterons du but de la société.
La société civile est encore une société parfaite. On désigne, dans l'Ecole, sous le nom de société parfaite ou complète celle qui possède, par elle-même, tous les moyens d'atteindre son but, en sorte qu'elle n'est pas destinée à trouver dans une société supérieure son complément et sa perfection.
C'est ce que le Souverain Pontife a plus brièvement exprimé dans l'encyclique Immortale Dei, en rappelant que l'Église est une société parfaite ; Elle possède, en soi et par elle-même, toutes les ressources qui sont nécessaires à son existence et à son action.
La société civile répond bien à cette définition de la société parfaite ; elle possède tous les moyens naturels de procurer à l'homme la félicité de cette vie, puisqu'elle supplée, en cela, tout ce qui manque à la société domestique ; et elle n'est pas destinée à faire partie d'une société supérieure de même ordre, puisque nous ne voyons pas, dans l'ordre naturel, de société à laquelle elle puisse être subordonnée.
Ainsi, la société civile est justement considérée comme une société parfaite, et le pouvoir suprême lui appartient dans les choses purement temporelles.
C'est encore l'enseignement du Saint-Père, dans la même encyclique ; parlant des deux sociétés, l'Église et l'Etat, il dit : Chacune d'elles, en son genre, est souveraine.
Enfin, la société civile est une société organique, c'est-à-dire qu'à l'exemple des corps vivants dont les membres ne sont pas animés d'un mouvement purement mécanique, mais jouissent chacun d'une vie propre, bien que dépendante de la vie du corps tout entier, la société civile se compose d'organes dont la vie et la constitution sont distinctes de la sienne, tout en lui restant subordonnés. Ces organes vitaux de la société civile, ce sont ses membres, c'est-à-dire les familles, les communes, les provinces : car la société civile ne se compose pas d'individus, elle se compose de sociétés moindres, antérieures à elle par leur nature, plus strictement nécessaires et plus directement instituées de Dieu: Ces sociétés ont leurs droits et leur constitution propres, que la société civile n'a pas le droit d'altérer ou de méconnaître, mais qu'elle a le devoir de sauvegarder.
La société civile n'est donc pas une collection d'individus égaux, mais une hiérarchie de sociétés subordonnées, auxquelles les individus peuvent appartenir à différents titres et dans lesquelles ils exercent des magistratures et des fonctions en rapport avec leur condition.
La constitution des sociétés modernes est loin de présenter ce caractère ; c'est là son tort et son malheur. Fondée pour l'individu, ne connaissant d'autres droits que les droits individuels et les droits de l'État, cette constitution sociale est fatalement conduite à osciller entre le libéralisme et le socialisme, pour tomber enfin dans une complète dissolution.
Toute définition de la société civile qui ne la présente pas comme un corps moral naturel, nécessaire, complet et hiérarchiquement organisé, doit donc être rejetée.
Mais il n'est pas possible de connaître la véritable nature et les caractères essentiels de la société civile, si l'on n'en précise nettement le but, la fin.
2° Fin de la société civile.
Il résulte de la constitution organique de la société civile que sa fin propre et immédiate ne peut être ni le bien individuel de chaque homme, ni le bien privé de chaque famille, mais le bien commun des familles et des autres associations qui lui sont subordonnées.
Ce bien commun est un bien temporel : car le bien spirituel est la fin propre de l'Église, et on ne saurait l'assigner pour but immédiat à la société civile, sans amener entre les deux pouvoirs une inévitable et funeste confusion ; c'est, de plus, un bien extérieur : car le bien intérieur, même temporel, de chaque homme est d'ordre individuel et privé, nullement d'ordre social ; enfin, ce bien temporel que doit procurer l'union des familles en une société parfaite consiste dans l'ordre et la prospérité publiques.
Cet ordre et cette prospérité ne sauraient être limités aux seules conditions matérielles de la vie, et doivent s'étendre à l'ordre moral tout entier ; en effet, le bonheur de l'homme, même en cette vie, ne consiste pas uniquement, ni même principalement, dans la satisfaction des exigences du corps ; il dépend surtout des dispositions intellectuelles et morales de l'âme ; la société civile ne serait donc pas une société naturelle et parfaite dans son ordre, ni même une société vraiment humaine, si elle ne tendait à procurer la félicité temporelle conformément à la nature de l'homme dans ce qu'il y a en elle de plus élevé et de proprement humain. La société doit donc pourvoir, par des moyens proportionnés à sa nature, au perfectionnement intellectuel et moral de l'homme.
Si nous voulons embrasser dans une même définition toute l'étendue de la fin de la société civile, nous dirons donc : La société civile a pour but le bien commun temporel de l'homme tout entier, en tant que ce bien peut être obtenu par les actions extérieures
Ainsi, c'est donner une définition incomplète et tronquée du but de la société, que de lui assigner la protection des droits et de la liberté de chacun, ou le maintien de la paix et de la sécurité publiques ; elle doit tendre à procurer le bien temporel de l'homme dans toute sa plénitude et son extension, mais seulement dans l'ordre public et en dehors de la sphère d'action des individus, des familles ou des associations.
Ainsi, le rôle de la société est très étendu : il atteint tout ce qui intéresse le bonheur et le perfectionnement de l'homme en cette vie, mais les limites en sont très nettement définies, puisque sa raison d'être et sa mission cessent là où commencent celles de la famille et des autres organes du corps social.
Cette conception de la fin de la société civile permet seule de rester à égale distance entre les deux écueils les plus redoutables en ces matières : le libéralisme et le socialisme.
20:12 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : souverainete, pie ix
07/06/2009
Regard sur notre époque.
Au moment ou notre pays s’enfonce chaque jour davantage dans le marasme économique et social, au moment ou la France trébuche dans l’anarchie, les vieux démons reprennent vie. Les mythes destructeurs de la nation, à l’instar de la lutte des classes, servent de justification à la révolte et à la violence urbaine. Certains leaders politiques de la gauche extrême y puisent une sorte de brevet révolutionnaire, une identification avec les « grands ancêtres » de la révolution de 1789. L’hostilité viscérale à l’entreprise et à l’autorité reste une constante idéologique de l’opinion publique.
Notre pays est miné par la montée continue des différentes formes d’insécurité. Le poids du communautarisme, l’effacement des repères identitaires et des valeurs morales qui ont structurés jadis notre civilisation en étant les principaux facteurs. La France subit une montée progressive de la violence, elle est le théâtre de nombreux affrontements brutaux, au relent de guerre civile. Ce processus funeste apporte la preuve irréfutable de l’inaptitude constante des Français (de la majorité) à régler par le dialogue démocratique les difficultés rencontrées au niveau de la Cité. Aujourd’hui chez nous, chaque débat, chaque négociation républicaine tourne à la querelle idéologique et engendre une contestation permanente…
Tout pousse à la rupture. L’immense mérite de nos Rois chrétiens a consisté, siècle après siècle, crise après crise, à panser les plaies, à atténuer les souffrances humaines, à apaiser les passions, à maintenir l’unité, à servir le bien commun. Quel contraste éclatant !
Alors aujourd’hui, il semble en effet que cette remise en ordre de manière durable, ne soit pas possible. L’autorité légitime ayant disparu, depuis plus de deux cents ans quelque chose est brisé, et notre beau pays dégringole allant de rupture en rupture. Cela tient tout d’abord au fait que Dieu a été chassé avec violence de nos institutions et de nos âmes. Il est désormais interdit de prononcer son nom dans une enceinte publique. De nombreuses conséquences découlent de cette apostasie. Et notamment cette faillite prévisible de l’éducation nationale.
La médiocrité et l’inadaptation des institutions actuelles ne sont plus à démontrer. Les esprits les plus éclairés savent bien que les institutions républicaines sont parfaitement incapables de discerner ou de servir le bien commun.
Et puis… n’oublions pas non plus, la façon dont on manipule l’opinion afin qu’elle se plie aux exigences de telle ou telle minorité agissante. Les partis politiques jouent un rôle déterminant dans la désintégration de la vie nationale. Ils se manifestent, à l’évidence, comme des ferments de division et des révélateurs des plus médiocres ambitions. Leur raison d’être essentielle se limite le plus souvent à la conquête où à la conservation d’un pouvoir éphémère. Un parti est d’abord, une machine électorale à la recherche permanente de candidats et de colleurs d’affiches... Le système oblige les éventuels candidats de bonne volonté à dissimuler leur véritable opinion, à ruser, à mentir, puis finalement à trahir ceux qui ont naïvement fait confiance. Il semble que la démagogie engendrée par le suffrage universel a encore de beaux jours devant elle, à moins que…. cette société, à bout de souffle ne s’effondre sur elle-même.
Si Dieu voulait bien prendre en pitié le « Royaume des Lys », il pourrait une fois encore, permettre que l’héritier de nos Rois renoue le fil brisé de notre histoire. D’aucuns penseront qu’il est bien tard, les choses étant trop avancées. Peut être bien… mais ce n’est pas en vain que la « providence » a donné l’espérance comme devise à la Maison de Bourbon. C’est donc à un long travail nécessaire de reconstruction que nous sommes conviés après ces 220 années de désordre croissant. Sans doute cette tâche dépasse nos pauvres forces humaines mais Dieu viendra à notre aide si nous acceptons, selon la parole de Saint Pie X de « tout restaurer dans le Christ ». Alors les individus et les nations reprendront le chemin de la conversion, la chrétienté rayonnera à nouveau sur l’occident et le Roi de France reviendra...
MARQUIS DES CHOUANS.

21:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chouan, royauté, révolution, élections
01/06/2009
L’Armée Catholique Royale sur Second life.

Venez nous rejoindre dans cet univers en 3 D, et découvrir le domaine de l’Armée Catholique Royale avec sa chapelle dédiée à la Sainte Vierge Marie, sa fontaine du Sacré-Cœur, sa statue Sainte Jeanne d’Arc ainsi que les nombreux portraits de nos Rois exposés dans les différentes pièces du château.
Vous serez accueilli par le Marquis des Chouans, qui se chargera d’être votre guide dans la découverte de ce monde Légitimiste virtuel. Venez participer à nos discussions et enrichir vos connaissances en matière de Monarchie Française, Traditionnelle et Catholique.
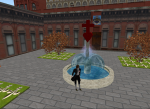
Notre action s’inscrit dans la continuité de celle des Chouans vendéens, Royalistes Légitimistes et Soldats de Dieu, nous ne jurons que par l’honneur de retrouver un jour notre chère patrie abandonnée…… la France !
N’hésitez plus, inscrivez vous gratuitement ici :
http://www.secondlifeforum.fr/sinscrire.php
Pour le téléchargement du programme c’est ici :
http://secondlifeforum.fr/telechargement.php
(Une permanence est tenue le premier mercredi de chaque mois de 18h30 à 19h30).

Vive Dieu, Vive le Roy.
11:48 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : internet, armée catholique royale, chouan, second life
30/05/2009
Introduction à la pensée légitimiste

Pour des royalistes, poser le problème politique uniquement sous l’angle institutionnel Monarchie/République, n’est pas satisfaisant. Il est vrai que seule l’institution monarchique assure la pérennité de l’autorité politique, et de fait la continuité d’une politique dans un pays : c’est ce qui fit dire à S.S. Pie VI que « la monarchie était en théorie la meilleure forme de gouvernement » (Déclaration du 17 Juin 1793).
Cependant, le pouvoir quasi absolu d’un seul n’est pas le propre de la monarchie, loin de là : la république (Ve du nom) nous offre le spectacle d’un régime républicain ― donc de nature instable ― qui a voulu pallier ses défaillances chroniques par l’institution gaullienne d’une dictature plébiscitaire.
Cette dictature est nécessairement plus oppressive que l’Ancien Régime dans lequel des catégories de français structurées les corps intermédiaires gouvernant leurs intérêts catégoriels comme des corps sociaux organisés, concourraient presque toujours à l’intérêt général (au besoin avec l’arbitrage suprême du roi). Aujourd’hui, le pouvoir central se mêle de toutes choses, gouverne tout et tout seul, donc gouverne mal.
La légitimité politique se définit historiquement par le respect des lois fondamentales de France, le serment du Sacre, et l’application d’une politique légitime. Ainsi, Clovis devient en 496, le seul roi légitime parmi les rois barbares du fait de son baptême et non de sa force. Le baptême, la légitimité dynastique, ne suffisent pas : encore faut-il une politique légitime. C’est le grand message d’Henri V, qui n’a pas voulu être le souverain légitime de la Révolution (c’est le sens de son refus symbolique du drapeau tricolore).
La marque politique de l’Ancienne France, ce avec quoi la Révolution a opéré une rupture, c’est la conduite d’une politique dominée par le Droit naturel et chrétien. Si aujourd’hui, nous descendons dans l’arène politique comme royalistes, c’est pour faire triompher ce Droit naturel et chrétien, au sein du mouvement légitimiste et armés de l’immense héritage de la pensée de la monarchie traditionnelle française transmise par nos pères depuis Clovis.
09:45 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : louis xx, légitimité, royalisme, monarchie
Les dernières heures de Sa Majesté le Roy Louis XVI.
 Le 20 janvier, le ministre de la Justice Garat vint signifier au Roy le décret qui le condamnait à mort. Le secrétaire du Conseil exécutif Grouvelle, chevrotant, lut la sentence. Le Roy l'écouta sans un mot. Il remit à Garat une lettre demandant un délai de trois jours pour se préparer à la mort, l'autorisation de revoir sa famille et d'appeler auprès de lui un prêtre de son choix. Pour ce ministère, il désignait l'abbé Henri Essex Edgeworth de Firmont. La Convention rejeta le délai, mais accorda les autres demandes. Le décret proposé par Cambacérès portait que «la nation française, aussi grande dans sa bienfaisance que rigoureuse dans sa justice, prendra soin de la famille du condamné et lui fera un sort convenable»
Le 20 janvier, le ministre de la Justice Garat vint signifier au Roy le décret qui le condamnait à mort. Le secrétaire du Conseil exécutif Grouvelle, chevrotant, lut la sentence. Le Roy l'écouta sans un mot. Il remit à Garat une lettre demandant un délai de trois jours pour se préparer à la mort, l'autorisation de revoir sa famille et d'appeler auprès de lui un prêtre de son choix. Pour ce ministère, il désignait l'abbé Henri Essex Edgeworth de Firmont. La Convention rejeta le délai, mais accorda les autres demandes. Le décret proposé par Cambacérès portait que «la nation française, aussi grande dans sa bienfaisance que rigoureuse dans sa justice, prendra soin de la famille du condamné et lui fera un sort convenable»
Ce « sort convenable », on le connaît…
Garat fit donc prévenir l'abbé Edgeworth et le ramena lui-même au Temple dans sa voiture. Le prêtre voulut échanger son habit bourgeois contre un costume ecclésiastique, mais Garat lui dit:
- C'est inutile, d'ailleurs le temps nous presse.
Le 20 janvier à six heures du soir, le confesseur entra chez le Roy. Tous les assistants s'étant écartés, ils restèrent seuls. Louis XVI parla un moment avec l'abbé et lui lut son testament. Puis il le pria de passer dans le cabinet voisin pour lui permettre de recevoir sa famille.
La porte s'ouvrit et la Reine entra, tenant son fils par la main ; derrière venaient Madame Elisabeth et Madame Royale. Tous pleuraient. Ils ne savaient rien de précis encore, mais ils craignaient le pire. Le Roy s'assit, entouré de son épouse et de sa soeur. Sa fille était en face de lui et il tenait l'enfant entre ses genoux. Avec de tendres ménagements, à voix basse, il les avertit. Par la porte vitrée, Cléry les vit s'étreindre en sanglotant.
Tenant ses mains dans les siennes, Louis XVI fit jurer à son fils de ne jamais songer à venger sa mort. Il le bénit et bénit sa fille. Par instants, il gardait le silence et mêlait ses larmes aux leurs. Cette scène poignante se prolongea plus d'une heure et demie… A la fin, quel que soit son courage, il n'en put plus. Il se leva et conduisit sa famille vers la porte. Comme ils voulaient rester encore et s'attachaient à lui en gémissant, il dit:
- Je vous assure que je vous verrai demain matin à huit heures.
- Vous nous le promettez? supplièrent-ils ensemble.
- Oui, je vous le promets.
- Pourquoi pas à sept heures? dit la Reine.
- Eh bien oui, à sept heures… Adieu.
Malgré lui, cet adieu rendit un son tel que les malheureux ne purent étouffer leurs cris. Madame Royale tomba évanouie aux pieds de son père. Cléry et Madame Elisabeth la relevèrent. Le Roy les embrassa tous encore, et doucement les poussa hors de sa chambre.
- Adieu, adieu, répétait-il, avec un geste navrant de la main.
Il rejoignit l'abbé Edgeworth dans le petit cabinet pratiqué dans la tourelle.
- Hélas, murmura-t-il, il faut que j 'aime et sois tendrement aimé!
Sa fermeté revenue, il s'entretint avec le prêtre. Jusqu'à minuit et demi, le Roy demeura avec son confesseur. Puis il se coucha. Cléry voulut lui rouler les cheveux comme d'habitude.
- Ce n'est pas la peine, dit Louis XVI.
Quand le valet de chambre ferma les rideaux, il ajouta : « Cléry, vous m'éveillerez demain à cinq heures.» Et il s'endormit d'un profond sommeil.
21 janvier 1793 :
A cinq heures, Cléry allume le feu. Au peu de bruit qu'il fait, Louis XVI ouvre les yeux, tire son rideau :
- Cinq heures sont-elles sonnées?
- Sire, elles le sont à plusieurs horloges, mais pas encore à la pendule.
- J'ai bien dormi, dit le Roy, j'en avais besoin, la journée d'hier m'avait fatigué. Où est Monsieur de Firmont?
- Sur mon lit.
- Et vous? où avez-vous dormi?
- Sur cette chaise.
- J'en suis fâché, murmure Louis XVI, soucieux toujours du bien-être de ses serviteurs.
- Ah, Sire, dit Cléry en lui baisant la main, puis-je penser à moi dans ce moment?
Il habille et coiffe son maître devant plusieurs municipaux qui, sans respect, sont entrés dans la chambre. Puis il transporte une commode au milieu de la pièce pour servir d'autel. Revêtu de la chasuble, l'abbé commence la messe, que sert Cléry. Le Roy l'entend à genoux et reçoit la communion, il remercie ensuite le valet de chambre de ses soins et lui recommande son fils.
- Vous lui remettrez ce cachet, vous donnerez cet anneau à la Reine, dites-lui que je le quitte avec peine… Ce petit paquet contient des cheveux de toute ma famille, vous le lui remettrez aussi. Dites à la Reine, à mes chers enfants, à ma soeur, que je leur avais promis de les voir ce matin, mais que j 'ai voulu leur épargner la douleur d'une séparation nouvelle…
Essuyant ses larmes, il murmure alors:
- Je vous charge de leur faire mes adieux.
Il s'est approché du feu, y réchauffe ses mains froides. Il a demandé des ciseaux pour que Cléry lui coupe les cheveux au lieu du bourreau. Les municipaux, défiants, les refusent.
Dans l'aube triste de ce dimanche d'hiver, un grand bruit environne la Tour. Alertées par la Commune, toutes les troupes de Paris sont sous les armes. L'assassinat, la veille au soir, de Lepeletier de Saint-Fargeau, l'exalté Montagnard, tué d'un coup de sabre par l'ancien garde du corps Deparis, a fait redoubler les précautions militaires. Partout les tambours battent la générale. Les sections armées défilent dans les rues, les vitres résonnent du passage des canons sur les pavés. A huit heures Santerre arrive au Temple avec des commissaires de la Commune et des gendarmes. Nul ne se découvre.
- Vous venez me chercher? interroge le roi.
- Oui.
- Je vous demande une minute.
Il rentre dans son cabinet, s'y munit de son testament et le tend à un municipal qui se trouve être le prêtre défroqué Jacques Roux.
- Je vous prie de remettre ce papier à la Reine… Il se reprend, et dit: « à ma femme. »
- Cela ne me regarde point, répond Roux. Je ne suis pas ici pour faire vos commissions, mais pour vous conduire à l'échafaud.
- C'est juste, dit Louis XVI.
Un autre commissaire s'empare du testament qu'il remettra non à la Reine, mais à la Commune *.
Louis XVI est vêtu d'un habit brun, avec gilet blanc, culotte grise, bas de soie blancs. Cléry lui présente sa redingote.
- Je n'en ai pas besoin, donnez-moi seulement mon chapeau.
Il lui serre fortement la main, puis, regardant Santerre, dit :
- Partons!
D'un pas égal, il descend l'escalier de la prison. Dans la première cour, il se retourne et regarde à deux reprises l'étage où sont les siens : au double roulement qui a retenti lorsqu'il a franchi la porte de la Tour, ils se sont précipités vainement vers les fenêtres, obstruées par des abat-jour.
- C'en est fait, s'écrie la Reine, nous ne le verrons plus!
Le Roy monte dans sa voiture, un coupé vert, suivi de l'abbé Edgeworth de Firmont. Un lieutenant de gendarmerie et un maréchal des logis s'assoient en face d'eux sur la banquette de devant. Précédés de grenadiers en colonnes denses, de pièces d'artillerie, d'une centaine de tambours, les chevaux partent au pas… Les fenêtres, comme les boutiques, par ordre restent closes. Dans la voiture aux vitres embuées, Louis, XVI la tête baissée, lit sur le bréviaire du prêtre les prières des agonisants.
Vers dix heures, dans le jour brumeux, la voiture débouche enfin de la rue Royale sur la place de la Révolution. A droite en regardant la Seine, au milieu d'un espace encadré de canons et de cavaliers, non loin du piédestal vide qui supportait naguère la statue de Louis XV, se dresse la guillotine. La place entière est garnie de troupes. Les spectateurs ont été refoulés très loin. Il ne sort de leur multitude qu'un faible bruit, fait de milliers de halètements, de milliers de soupirs. Tout de suite, sur un ordre de Santerre, l'éclat assourdissant des tambours l'étouffe…
L'exécuteur Sanson et deux de ses aides, venus à la voiture, ouvrent la portière ; Louis XVI ne descend pas tout de suite ; il achève sa prière. Au bas de l'échafaud, les bourreaux veulent le dévêtir. Il les écarte assez rudement, ôte lui-même son habit et défait son col. Puis il s'agenouille aux pieds du prêtre et reçoit sa bénédiction. Les aides l'entourent et lui prennent les mains.
- Que voulez-vous? dit-il.
- Vous lier.
- Me lier, non, je n'y consentirai jamais!
Indigné par l'affront, son visage est soudain devenu très rouge. Les bourreaux semblent décidés à user de la force. Il regarde son confesseur comme pour lui demander conseil. L'abbé Edgeworth murmure:
- Faites ce sacrifice, Sire; ce nouvel outrage est un dernier trait de ressemblance entre Votre Majesté et le Dieu qui va être sa récompense.
- Faites ce que vous voudrez, je boirai le calice jusqu'à la lie.
On lui attache donc les poignets derrière le dos avec un mouchoir, on lui coupe les cheveux. Puis il monte le roide degré de l'échafaud, appuyé lourdement sur le bras du prêtre. A la dernière marche il se redresse et, marchant d'un pas rapide, il va jusqu'à l'extrémité de la plate-forme. Là, face aux Tuileries, témoins de ses dernières grandeurs et de sa chute, faisant un signe impérieux aux tambours qui, surpris, cessent de battre, il crie d'une voix tonnante :
- Français, je suis innocent, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que le sang qui va être répandu ne retombe jamais sur la France ! Et vous, peuple infortuné…
A cheval, Beaufranchet, adjudant général de Santerre, se précipite vers les tambours, leur jette un ordre. Un roulement brutal interrompt le Roy. Il frappe du pied l'échafaud :
- Silence, faites silence!
On ne l'entend plus. A quatre, les bourreaux se jettent sur lui, l'allongent sur la planche. Il se débat, pousse un cri… Le couperet tombe, faisant sauter la tête dans un double jet de sang qui rejaillit sur l'abbé Edgeworth. Sanson la prend et, la tenant par les cheveux, la montre au peuple. Des fédérés, des furieux escaladent l'échafaud et trempent leurs piques, leurs sabres, leurs mouchoirs, leurs mains dans le sang. Ils crient « Vive la nation! Vive la République! »
Quelques voix leur répondent. Mais le vrai peuple reste muet. Pour le disperser, il faudra longtemps… L'abbé descend de la plate-forme et fuit, l'esprit perdu. Une tradition lui a prêté ces mots, adressés au Roy comme adieu : “Fils de Saint Louis, montez au ciel!“
Source : Le Blog du Mesnil Marie
08:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis xvi, revolution, clery