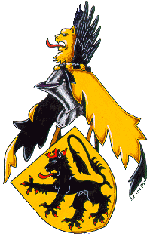18/07/2010
Le drapeau de la France réelle.
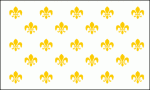
A notre époque, nos compatriotes estiment à tort que le drapeau tricolore est un symbole irréfutable de notre pays. On le retrouve constamment mis en évidence et à l'honneur dans les divers mouvements du patriotisme républicain où se réclamant du nationalisme Français.
C'est oublier un peu vite que la France réelle n'est pas née en 1789 comme veulent absolument nous le faire croire les révolutionnaires à travers les manuels scolaires de l'éducation nationale, mais qu'elle est née avec le baptême de Clovis.
En ce sens, le Français soucieux de défendre la tradition politique de notre pays devra s'interroger sur la légitimité de ce "bleu blanc rouge". Car en effet, on ne peut se contenter de défendre un patriotisme irréfléchi et stérile.
Ce drapeau loin d'être celui de la France, est au contraire celui de la république et des prétendues valeurs défendues par cette dernière.
Il est illégitime car il a été imposé par la violence, de la même manière que le roi Louis XVI a été contraint de se coiffer du bonnet phrygien. Dès son apparition, il est le symbole du rejet brutal de la Royauté et de la religion Catholique.
Un royaliste sincère et soucieux de défendre la Monarchie Française, ne peut épouser le tricolore. Qui est, rappelons-le, une composition habile sortie tout droit de l'imaginaire du Franc-maçon La Fayette.
Stupéfiante incohérence et insupportable contradiction des partis politiques républicains qui pensent honorer Sainte Jeanne d'Arc en agitant le tricolore, et en chantant la Marseillaise à l'occasion de cérémonies et commémorations !

N'oublions jamais que la Sainte de la patrie a servi les Lys. Qu'elle incarne donc en vérité le combat Royaliste et Catholique par excellence. Sa mission première étant de redonner confiance au dauphin :
"Tu es le vrai héritier de France et fils de roi".
Ensuite, elle devait le faire sacrer, lui et non la NATION à Reims.
Elle rappelait explicitement au Roi ce qui était implicite depuis Clovis, à savoir que le vrai Roi de France est Notre-Seigneur Lui-même et que le roi d'ici-bas n'est que son lieu-tenant.

Le combat de Sainte Jeanne d'Arc n'a absolument rien à voir avec le drapeau tricolore, qui est celui des bourreaux du Roi Louis XVI, de la Reine Marie-Antoinette, de Louis XVII et de tant d'autres encore... Ce drapeau est entaché du sang des Chouans, des Vendéens et de tous les martyres Catholiques, prêtres et laïcs victimes de la cruauté des soldats de la révolution "des droits de l'homme"...
Ces trois couleurs ne sont pas celle de la vraie France Catholique, Royale, Traditionnelle et Légitime.
Relisons avec intérêt ce message du comte de Chambord qui a su refuser cette imposture pour conserver toute sa fidélité à la tradition politique de notre pays. Tradition que sa personne a incarné avec droiture et honneur à un moment donné de l'histoire :

FRANÇAIS !
Je suis prêt à tout pour aider mon pays à se relever de ses ruines et à reprendre son rang dans le monde. Le seul sacrifice que je ne puisse lui faire est celui de mon honneur. Je suis et je veux être de mon temps, je rends un sincère hommage à toutes ses grandeurs, et quelle que fut la couleur du drapeau sous lequel marchaient nos soldats, j’ai admiré leur héroïsme, et rendu grâce à Dieu de tout ce que leur bravoure ajoutait aux trésor des gloires de la France. Entre vous et moi, il ne doit subsister ni malentendu, ni arrière-pensée. Non, je ne laisserai pas, parce que l’ignorance ou la crédulité auront parlé de privilèges, d’absolutisme, ou d’intolérance, que sais-je encore? de dîme, de droits féodaux fantômes, que la plus audacieuse mauvaise foi essaie de ressusciter à vos yeux, je ne laisserai pas arracher de mes mains l’étendard d’Henri IV, de François 1er et de Jeanne d’Arc. C’est avec lui que vos pères, conduits par les miens, ont conquis cette Alsace et cette Lorraine dont la fidélité sera la consolation dans nos malheurs. Il a vaincu la barbarie sur cette terre d’Afrique, témoin des premiers faits d’armes des princes de ma famille. C’est lui qui vaincra la barbarie nouvelle dont le monde est menacé. Je le confierai sans crainte à la vigilance de notre armée : il n’a jamais suivi, elle le sait, que les chemins de l’honneur. Je l’ai reçu comme un dépôt sacré du vieux Roi mon aïeul, mourant en exil. Il a toujours été pour moi inséparable du souvenir de la patrie absente, il a flotté sur mon berceau et je veux qu’il ombrage ma tombe.
Dans les plis glorieux de cet étendard sans tache, je vous apporterai l’Ordre et la Liberté.
Henri V ne peut abandonner le drapeau blanc d’Henri IV.
Chambord, 5 Juillet 1871
Henri.
18:46 | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : drapeau bleu blanc rouge, louis xvi, monarchie, jeanne d'arc, comte de chambord, révolution, légitimité, clovis, royalisme, honneur, fidélité, tradition
07/05/2010
LOUIS XVII

Le Dauphin dans la tourmente révolutionnaire
Menant une existence protégée à Versailles, entouré de l’amour des siens et de l’attention de la Cour, l’enfant royal vit dans l’insouciance -et sans doute dans l’ignorance -le fatidique été 1789. Il ne prend sans doute conscience de la violence révolutionnaire que lorsque celle-ci vient frapper à la porte du château les 5 et 6 octobre 1789. Au cours de ces journées, des femmes parmi lesquelles des hommes déguisés forcent les portes du château et emmènent de force la famille royale à Paris, derrière les têtes coupées de quelques gardes, promenées en tête de cortège. Premier traumatisme pour le tout jeune Dauphin.
Le lendemain matin, effrayé d’entendre à nouveau des manifestants devant le nouveau château, le jeune garçon se jette dans les bras de sa mère : « Maman ! Est-ce qu’aujourd’hui est encore hier ? » demande-t-il, terrorisé à l’idée de revivre ce cauchemar.
Le second traumatisme d’importance a lieu au retour du fameux voyage de Varennes, le 22 juin 1791, lorsqu’une foule de révolutionnaires déchaînés escorte la voiture du roi jusqu’à Paris, au cours d’un périple de trois jours sous une chaleur accablante, et pendant lequel un noble puis un prêtre furent sauvagement massacrés sous les yeux du couple royal et de ses enfants.

Pendant le terrible voyage du retour de Varennes, Louis-Charles s’attristait davantage de l’affliction de ses parents que de son propre sort. Il fut ainsi fort peiné d’entendre son père décrire ainsi la situation en la comparant à la glorieuse visite qu’il avait faite en 1786 au port militaire de Cherbourg, et pendant laquelle tout son peuple l’avait acclamé, alors qu’il descendait dans les auberges et se mêlait à lui, prenant des bains de foule et faisant la charité à tous : « C’est, monsieur, un bien triste voyage pour mes enfants. Quelle différence avec Cherbourg ! La calomnie à cette époque n’avait point encore égaré l’opinion. Comme les esprits sont prévenus ! Comme les têtes sont montées ! On peut me méconnaître, mais on ne me changera pas, moi; l’amour de mon peuple demeurera le premier besoin de mon coeur, comme il est le premier de mes devoirs. »
Ainsi parlait le Roi. Quand Louis-Charles entendit ces paroles édifiantes, une grosse larme roula sur sa joue. Alors cet enfant, avec tendresse et dignité, prit la grosse main de son père dans les siennes, minuscules, et y déposa un baiser. Et, ignorant son propre chagrin, sa propre peur et les symptômes dus à l’insolation et au manque d’air, il entreprit de consoler son père avec une touchante abnégation, luttant pour produire un sourire réconfortant à travers ses larmes. « Ne vous attristez point, mon père, une autre fois nous irons à Cherbourg. »
La Famille Royale en prison
Toute la vie de Louis-Charles s’écroule le 10 août 1792, lorsque les gardes fédérés et les sans-culottes levés par les factions investissent les Tuileries et perpétuent un abominable massacre sur la garde suisse qui s’était rendue. Louis-Charles n’assiste pas à cette scène, car il est prisonnier avec sa famille dans la loge du logographe à l’Assemblée Nationale. A partir de cet instant, il ne connaîtra plus jamais la liberté. Violemment perturbé par l’irruption dans la salle des délibérations de soudards couverts de sang qui menacent de mort le Roi, Louis-Charles est transféré avec les siens dans la forteresse du Temple le 13 août. Il n’en ressortira jamais plus.
Au début, la famille royale est réunie. L’enfant partage sa captivité avec ses parents, sa soeur aînée Marie-Thérèse, sa tante Madame Elisabeth et deux fidèles serviteurs nommés Hue et Cléry. De nombreux livres sont accessibles dans les archives de la forteresse, ce qui permet aux adultes de poursuivre l’instruction et l’éducation des enfants, le tout au milieu des brimades quotidiennes de gardiens fanatisés. Louis-Charles, pourtant, ne se départ pas de sa joie de vivre, heureux de passer du temps avec son père, et trouvant toujours à s’occuper entre ses leçons, ses jouets et ses promenades dans la cour -même si ces dernières sont l’occasion d’un redoublement de vexations de la part des gardes.
Séparé une première fois de sa mère, le garçon vit un mois en compagnie de son père, puis est remis aux femmes pendant toute la durée du procès de Louis XVI. Il ne reverra son père que la veille de son exécution. La scène est déchirante. Louis XVI fait promettre à son fils de pardonner à ses bourreaux, et de ne jamais chercher à venger sa mort. Louis-Charles n’oubliera jamais cette recommandation et s’efforcera jusqu’à la fin de sa courte vie à chasser toute haine de son coeur. Le lendemain matin, 21 janvier 1793, son père est guillotiné. Tandis qu’on emmenait son père, l’enfant se jetait aux pieds des gardes en leur suppliant de le laisser descendre pour parler aux révolutionnaires et leur implorer d’épargner son père. Mais en vain : à dix heures vingt ce jour-là, Louis-Charles devient Louis XVII. Il avait bientôt huit ans.

Sa mère fait venir des vêtements de deuil pour elle et ses enfants. Vêtu d’un costume noir, Louis-Charles continue à étudier avec sa mère et sa tante Madame Elisabeth. Les jours où les gardiens en faction se montrent compatissants, elle lui apprennent des chansons. La belle voix du jeune garçon résonne alors dans la lugubre tour...
En mai, Louis-Charles tombe gravement malade. Il est alité et a une très forte fièvre. Les conditions de vie insalubres qu’on lui inflige depuis neuf mois l’ont rendu tuberculeux. Pendant deux ans, il luttera avec une robustesse étonnante contre cette maladie qui finira par avoir raison de lui... ainsi que les mauvais traitements qui vont dès lors devenir insoutenables.
La cruelle tutelle de Simon
Le 3 juillet 1793, le petit garçon tuberculeux est arraché sans ménagement à l’amour de sa mère et de sa famille.Marie-Antoinette s’agenouilla à la hauteur de son enfant et le prit dans ses bras. Comme le petit garçon est suffoqué par les sanglots, elle fixe son attention en le regardant bien en face et en lui parlant d’une voix douce, les mains sur ses épaules étroites agitées de soubresauts. « Mon enfant, nous allons nous quitter. Souvenez-vous de vos devoirs quand je ne serai plus auprès de vous pour vous les rappeler. N’oubliez jamais le bon Dieu qui vous met à l’épreuve, ni votre mère qui vous aime. Soyez sage, patient et honnête, et votre père vous bénira du haut du ciel. »
Puis elle fait un dernier câlin au petit. Après cela, elle confie l’enfant en larmes aux commissaires. Louis-Charles commence par faire un pas vers la porte, mais cet horrible pressentiment qu’il ne reverra plus jamais sa mère est toujours là, et au moment de franchir le seuil il échappe à ses geôliers et court se réfugier dans les bras de Marie-Antoinette. Fou de chagrin, il enfouit son visage dans la robe de sa mère. « Allons, il faut obéir, il le faut », dit la Reine en s’évertuant à paraître forte et digne, mais déjà sa voix s’éteint dans les sanglots, et on sent tout l’effort que lui coûte cette simple phrase.

Désormais, Louis-Charles devra vivre au second étage de la tour, sous la tutelle du cordonnier Antoine Simon, un révolutionnaire fanatique que la Convention a chargé « d’éduquer » le jeune roi pour en faire un parfait sans-culotte. Ne pouvant sacrifier un tel otage, les révolutionnaires ont trouvé une solution intermédiaire pour éliminer cette incarnation de la royauté qu’est Louis-Charles : en faire un souverain sans-culotte.
Tous les jours, le petit garçon subit rosseries et humiliations. Terrorisé, ployant sous les coups, ne cessant de pleurer l’absence de sa mère à laquelle on l’a arraché pour le livrer à Simon, il est sommé de jurer fidélité à la République, et d’apprendre par coeur des chants révolutionnaires et paillards. Il résista noblement au début, exigeant même qu’on lui montrât le décret ayant ordonné tant de souffrances, puis, brisé, il dut se soumettre à toutes les exigences de son maître.

Pour Louis-Charles les humiliations étaient pires encore quand Simon amenait avec lui dans la tour ses amis de beuverie, devant lesquels il aimait se vanter, démonstration à l’appui, de mater le jeune Roi de France. Le 6 août, la ville de Montbrison s’étant soulevée contre l’oppression au cri de « vive le Roi Louis XVII! », Simon présenta le petit Prince à la cantonade en déclamant : « Voici le Roi de Montbrison. Je m’en vais l’oindre, l’encenser et le couronner! »
Et, joignant le geste à la parole, il l’oignit en lui renversant son verre sur la tête et en lui frottant douloureusement les cheveux, l’encensa en lui soufflant des bouffées de sa pipe à la figure et le couronna en le coiffant du bonnet phrygien. Tous les convives hurlaient de rire, monstres se pâmant devant les sévices infligés à un enfant. Devant la petite figure rouge de colère et de honte de Louis-Charles, l’immonde précepteur demanda alors à sa jeune victime : « Que me ferais-tu, Capet, si tes amis te délivraient et si tu devenais Roi de France pour de vrai? »
Et alors cet enfant, cet enfant qui avait les meilleures raisons du monde pour souhaiter le malheur de Simon, cet enfant imposa le silence et le respect à tout le monde en répondant : « je vous pardonnerais ».
Ce jour-là, à n’en pas douter, le bon Roi Louis XVI dut, comme l’avait dit Marie-Antoinette, bénir son enfant du haut des cieux. Car il fallait voir avec quelle grandeur d’âme son fils honorait ses dernières volontés! Car c’était ainsi que ces deux grands Rois martyrs (le jeune âge du second n’excluant pas la grandeur) se vengeaient de leurs bourreaux : par leur invincible Pardon.
En octobre, le journaliste Hébert, le procureur Chaumette et le maire Pache conçoivent un plan répugnant (et parfaitement inutile) pour charger le dossier d’accusation de Marie-Antoinette dont le procès va s’ouvrir. Simon sera leur instrument. A force de coups, de jeûnes forcés, de saouleries et de menaces de guillotine -menaces qui faisaient s’évanouir de terreur le pauvre enfant-, Simon et ses commanditaires parvinrent à contraindre Louis-Charles, en présence de sa soeur et de sa tante, à confirmer et à signer, alors même qu’il n’en comprenait pas le sens, une déposition écrite et inventée de toutes pièces par l’infâme Hébert, et qui accusait Marie-Antoinette d’attouchements. La signature de l’enfant au bas du procès verbal, tremblée et méconnaissable, est un aveu criant des mauvais traitements qu’il subissait, de son bouleversement, de son état de délabrement psychologique et de la violence qu’on lui faisait pour qu’il exécute l’horrible volonté de ses tortionnaires.
L’emmurement et l’agonie

Malgré tout ce que Louis-Charles avait déjà subi, le pire n’arriva que le 19 janvier 1794, quand la Convention décida qu’elle avait assez perdu de temps avec le petit roi. Commence alors la période de l’emmurement, qui durera six mois. Le jeune roi, qui va sur ses neuf ans, est jeté au fond de sa chambre, dont on condamne la porte. Pendant six mois sans interruption, il vivra dans cette pièce minuscule, où n’entre pas même la lumière du jour puisque la fenêtre, comme la porte, est condamnée. La nourriture lui est passée à travers un guichet. Aucun accès au cabinet d’aisance : l’enfant, qui est déjà malade, va vivre pendant six mois au milieu de ses déjections. Il n’a ni visite, ni lumière, ni livre, ni jouet pour se distraire. Terrorisé, malade, rejeté de tous, écrasé par le chagrin, il est sur le point de mourir d’inanition lorsque Robespierre est renversé le 28 juillet 1794 (9 thermidor). Le soir même, Barras, nouvel homme fort du régime, se rend à la prison du Temple et fait sortir l’enfant de son isolement. Louis-Charles est dans un état qui dépasse l’imagination. Sa seule parole, lorsque ses nouveaux geôliers ouvrent enfin la porte de sa cellule après six mois d’isolement, est pour leur dire qu’il voudrait mourir.
Il faudra pourtant attendre encore un mois pour que ses gardiens le lavent, le soignent, lui coupent les cheveux et les ongles, l’habillent de linge frais et nettoient sa chambre de fond en comble. Trois gardiens se succèderont d’ici la mort de l’enfant : Christophe Laurent, Jean-Baptiste Gomin et Etienne Lasne. Ces hommes se montrèrent humains et firent de leur mieux, dans la mesure de leurs maigres moyens, pour adoucir le sort de l’enfant royal et le distraire un peu. Mais Louis-Charles est au-delà de cela désormais : en état de catalepsie, tuberculeux au dernier degré, il n’a plus aucune force et ne parle presque jamais, sauf pour donner des réponses très brèves que ses gardiens doivent lui soutirer avec insistance. Il ne gémit même pas de douleur, alors que ses poignets et ses genoux sont noués par une arthrose tuberculeuse qui le fait terriblement souffrir. Il a bien trop peur des hommes désormais pour leur faire confiance, et seules les cajoleries d’une mère pourraient peut-être l’aider à sortir de son silence.
Et justement, toutes les pensées de l’enfant vont vers sa mère. Il ignore que Marie-Antoinette a été guillotinée le 16 octobre 1793, et pense qu’elle est toujours enfermée au troisième étage de la tour. Un jour, rassemblant ses dernières forces et ses dernières volontés, l’enfant moribond, qui ne parle presque jamais, demande à Gomin de le laisser revoir sa mère une dernière fois avant de mourir. Une requête que le gardien ne peut évidemment accorder.
Une semaine plus tard, le garçon entre dans le dernier tournant de son agonie. Il ne lui reste plus que deux jours à vivre, et c’est alors, et seulement alors, que le médecin décide de le tirer de son cachot pour l’allonger dans une belle chambre bleue, illuminée par le soleil, à l’autre bout du bâtiment. Louis-Charles a l’air de s’y remettre, mais au matin du dernier jour, son mal a tant empiré qu’il en devient intransportable. Veillé par Gomin et Lasne, le petit garçon souffre terriblement. Sa maladie a en effet dégénéré en péritonite tuberculeuse. Délirant de fièvre, il croit entendre sa mère chanter. Retrouvant un ultime éclair de joie, il se redresse, tire sur le bras de son gardien, se penche pour lui faire une confidence...et meurt dans ses bras. En ce 8 juin 1795, le petit martyr s’en est allé. Il avait dix ans, deux mois et douze jours.

S.A.R. Louis Alphonse de Bourbon (Louis XX)
S.A. le duc d’Anjou tient l’urne en cristal qui contient le cœur de Louis XVII lors de la cérémonie solennelle de déposition de cette relique dans la Basilique de Saint-Denis, à Paris, le 8 juillet 2004
10:22 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : louis xvii, enfant roi, martyre, révolution
22/04/2010
L’action de l’Etat Républicain contre la famille chrétienne.
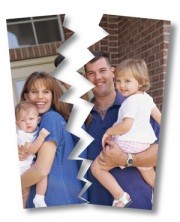
Peu soucieuse des péripéties de l’histoire, de la politique ou du droit, la Révolution satanique poursuit inexorablement son oeuvre. L’hyène sanguinaire, renonçant à guillotiner les têtes par centaines sur les places publiques, préfère maintenant les écraser par milliers dans le ventre des mères. Dénonçée, combattue, freinée, momentanément vaincue même, elle n’en continue pas moins d’avancer de sa démarche torse, selon les périodes, à petits pas, à pas feutrés ou, au contraire, à pas de géant lorsqu’elle parvient à rendre la torpeur à ce point générale qu’elle est de plus en plus seule à pouvoir mesurer ses triomphes, la gloire recherchée par Satan n’étant pas de triompher des hommes devant les hommes, piètre satisfaction, mais de triompher des hommes contre Dieu, orgueil suprême, le seul qui puisse lui convenir.
La révolution progresse en ce moment irrésistiblement car son maître a réussi cet exploit de mettre à son service, non seulement ceux qu’il a toujours suscités pour la propager mais aussi la plus grande partie de ceux qui devraient la combattre mais qui, pour ne pas s’avouer vaincus, sont allés traîtreusement grossir les troupes de l’Ennemi, l’ouverture au monde qu’ils invoquent pour se justifier ne parvenant pas, malgré tous leurs efforts, à dissimuler leur piteuse capitulation devant ce Monde pour lequel le Christ a refusé de prier. Pourtant, il faut bien constater que, depuis 1789 et jusqu’au dernier Concile, c’est l’Eglise Catholique qui, dans notre pays notamment, a permis à la République issue de la Révolution de durer pendant plus de deux siècles. Elle s’est efforcée pendant tout ce temps - avec qu’elle persévérance et au prix de quels abandons ! - de pactiser avec la révolution en lui apportant, non pas, bien sûr, un « supplément d’âme », mais ce minimum d’âme qui lui était nécessaire pour se rendre supportable.
C’est paradoxalement peut être, le « fruit de Concile » le plus évident - sinon le plus inattendu - que ce renoncement de l’Eglise à rendre la Révolution un peu moins contraire à l’ordre naturel, un peu moins inhumaine, en « s’ouvrant au monde », ce qui ne signifie pas autre chose que de l’abandonner à lui-même, à défaut de le rejoindre...Dans ce « mariage adultère de l’Eglise et de la Révolution dont ne pouvait naître (au moindre mal) que des bâtards » ce n’est pas l’Eglise qui a baptisé la Révolution mais c’est la Révolution qui a fait de nouveaux adeptes.
Ainsi, pendant deux siècles, l’Eglise a permis à la Révolution, quel que soit l’adjectif dont on l’affuble - libérale, socialiste, marxiste ou mondialiste... - de disposer du temps nécessaire pour amener les esprits, d’abord par l’école puis par les puissants moyens de communication, à détruire eux-mêmes la civilisation occidentale et chrétienne, son but ultime.Ses idées, dont beaucoup et notamment les plus essentielles sont communes aux différents aspects sous lesquels elle se présente tour à tour ou simultanément, imprègnent les mentalités, les sensibilités, les volontés, les intelligences (le communisme peut bien officiellement disparaître puisque ses erreurs restent tenacement répendues partout, comme Satan peut bien faire croire qu’il n’existe pas puisque son action ne cesse de s’exercer sur nous tous par la tentation).
Bien évidemment, la Révolution ne pouvait que vouloir la disparition de la famille, base de la civilisation occidentale et chrétienne et, qui plus est, d’institution divine (« ce sacrement est grand »). L’objet de cette étude est de décrire comment elle arrive patiemment à ses fins par la voie de réformes législatives avec toutefois l’accélération rapide de ces dernières années, causée précisement par l’incapacité actuelle de l’Eglise Catholique d’exercer une influence quelconque dans ce domaine, comme dans bien d’autres (hélas !) .
L’explosion de 1789 alla tout de suite au bout de la logique révolutionnaire et rompit totalement avec la conception traditionnelle de la famille en laïcisant le mariage devenu contrat civil, comme n’importe quel autre contrat, pouvant être rompu par consentement mutuel, le divorce étant aussi largement admis.Bien sûr, comme dans tous les cas où l’idéologie se heurte trop brusquement à la réalité, il fallut « reculer pour mieux sauter », revenir en arrière pour s’y prendre autrement.Ce fut l’oeuvre du Code Civil de 1804. Comme on ne supprime bien que ce que l’on remplace, pour détruire une institution religieuse, il n’y a rien de mieux que de la « singer ».
L’Etre Suprême ou la Déesse Raison « singe » Dieu. L’enseignement laïque « singe » l’enseignement catholique (et non pas l’inverse comme les autorités ecclésiastiques l’ont cocassement proclamé, il n’y a pa si longtemps) et nous voyons bien actuellement à quel degré de « singeries » il en est arrivé.De la même manière, le mariage du Code Civil « singe » le mariage religieux car s’il reste, bien sûr, un contrat civil, il est réglementé sur de nombreux points par des emprunts au droit canonique. Le divorce devient difficile et sera même supprimé en 1816.

En tous cas, le Code Civil, sans reprendre en tous points le droit de l’Ancien Régime, revient nettement sur les réformes révolutionnaires.
La Révolution recule donc.. momentanément et comprend qu’avant de revenir à la charge il faut préparer les esprits. D’où son combat acharné et victorieux pour l’école laïque, instituée en 1881 avec Jules Ferry. Elle va alors oeuvrer à la transformation progressive de la société, et surtout des moeurs, et reprendra l’offensive avec la Loi Naquet du 27 juillet 1884 sur le divorce organisé comme un régime d’exception (tactique qui sera reprise plus tard pour l’avortement), sans divorce par consentement mutuel, en améliorant cependant le sort des enfants naturels. Mais c’est essentiellment à partir du début du XXè siècle qu’elle mettra en place le plan qui lui permettra d’aboutir à ses fins.
Se réclamant, dirait-on aujourd’hui, du «principe de protection», l’Etat va intervenir de plus en plus dans la vie familale, comme l’a mis en lumière le Doyen Carbonnier dans un article remarqué sur « la Famille, 50 années de transformations dans la famille française » paru dans l’édition 1983 de son célèbre ouvrage Flexible droit pages 139 et suivantes. Le Doyen fait bien ressortir que cette époque se caractérise essentiellement par l’ ETATISATION de la famille car l’état intervient pour protéger la famille contre l’illetrisme, contre la pauvreté et contre l’autoritarsime des parents : ce sont les lois sur l’instruction publique obligatoire, sur les prestations familiales et sur l’assistance éducative.
A partir des années 1960, trois idéologies fondamentales vont inspirer une inflation considérable des réformes du droit de la famille accentuant radicalement la tendance manifestée précédemment.
La première de ces idéologies issue directement des Lumières est celle de la prééminence de la volonté individuelle, non plus seulement membre de la famille. Il devient normal que chaque personne puisse décider à sa guise de sa vie familiale. Cette recherche égoïste du bonheur individuel a pour conséquence l’instabilité de la famille et la perte de sa cohérence, et ruine la notion même de famille basée, au contraire, sur la recherche du bonheur des autres par le don de soit.
Les deux autres idéologies qui interviennent puisamment sur le droit comtemporain de la famille sont aussi anciennes que la première mais elles sont actuellement véhiculées dans toute l’Europe avec insistance sous l’influence de la Convetion Européenne des Droits de l’Homme.
Il s’agit de l’égalité absolue, d’une part, entre l’homme et la femme et, d’autre part, entre tous les enfants qu’ils soient légitimes, naturel ou adulterins.
Ainsi, après les lois de 1965, 1970, 1975 et 1985, les époux peuvent agir seuls, la femme peut notamment avorter sans le consentement de son mari. Le divorce par consentement mutuel est rétabli et un projet de loi prévoit le divorce-répudiation « car au XXIè siècle, on n’oblige pas les egns à vivre ensemble s’ils n’en ont plus envie ». Plusieurs lois successives bouleversent dans le même esprist la législation sur l’adoption en 1966, 1976, 1996 sur l’autorité parentale qui se transforme en démocratie parentale avec des lois de 1964, 1970, 1987, 1993, 2002 consacrant la dissociation du couple et de la parenté, sur les régimes matrimoniaux en 1956, sur la filiation en 1972, 1982, 1993, 1994, l’enfant naturel entrant dans la famille de son auteur (art. 334 du Code Civil).En même temps qu’il mettait en place les causes de la désagrégation de la famille, le législateur s’évertuait à tenter d’en limiter les effets dans « l’intérêt de l’enfant ». Ce vague critère de l’intérêt de l’enfant est donc devenu omniprésent en droit. Il concerne aussi bien l’adoption que l’autorité parentale destinée à « protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité (sic)» (article 371 - 2 du Code Civil) ou les mesures éducatives.
Mais il fallait aussi prévoir, bien sûr, le règlement des difficultés provenant d’une opposition pouvant survenir entre les époux idéologiquement, et non logiquement, égaux en ce qui concerne aussi bien la vie de la famille que l’appréciation de l’intérêt de l’enfant. Le droit contemporain a donc consacré le fameux « ménage à trois », le Juge aux Affaires Familiales pouvant intervenir en de multiples occasions dans la vie familiale, la loi ne pouvant jamais appréhender l’infinie variété de l’immense complexité du phénomène familial. Le juge s’est donc vu octroyer une marge de manoeuvre considérable pour s’immiscer dans la vie familiale. Il peut prononcer la séparation de corps et même le divorce quelle qu’en soit la cause. Le chef de famille n’existant plus, il fallait bien qu’un tiers le remplace. La famille, même provenant d’un mariage légitime, est ravalée au rang d’un simple groupement de fait : le droit appartient au juge.
C’est pourquoi, en même temps qu’il déposait ainsi une multitude de mines prêtes à exploser à l’intérieur de la famille légitime, le législateur s’est efforcé de lui nuire, de l’extérieur, en donnant un statut juridique à des situations de fait ayant pour but non seulement d’imiter mais de parodier le mariage et la famille. C’est toujours la même technique qui est mise en oeuvre : pour détruire, il faut remplacer pour remplacer, on ne peut que « singer ». La loi du 15 novembre 1999 institue le Pacte civil de solidarité, pseudo mariage temporaire, et, pour la première fois, définit légalement le concubinage. mais, qui plus est, ce nouveau contrat et cette union de fait peuvent exister entre deux personnes du même sexe, parodies grotesques du mariage tournant la famille en dérision. Le législateur commence aussi à s’intéresser aus familles « monoparentales » et aux familles « recomposées » dont les appelations signifient bien ce qu’elles sont. Le caractère éminement institutionnel du mariage et de la famille traditionnelle s’est effacé peu à peu au point de disparaître totalement.
Le mariage et la famille malgré encore quelques apparences trompeuses sont livrés à la libre fantaisie des époux qui peuvent, en réalité, règler leurs rapports comme ils veulent, les conflits qui ne manqueront pas de naître entre eux étant naturellement réglés par un tiers qui sera de moins en moins un juge mais le plus souvent un médiateur ou autre psychologue, sociologue, bientôt familiologue délégué par lui. Le libéralisme avait préparé les esprits à la disparition du mariage, le socialisme à réaliser l’essentiel des réformes. Le libéralisme actuellement au pouvoir n’a plus qu’à parachever cette grande oeuvre révolutionnaire : prélude à la sauvagerie méthodiquement organisée.
Pourtant la loi devrait, systématiquement favoriser la famille légitime fondée sur le mariage, la plus féconde parce que la plus stable, la plus éducative de la vie en commun et la mieux placée pour faire de l’enfant un homme. Si vous voulez apprendre à un enfant à se dominer et à contrôler ses pulsions, si vous voulez lutter contre la délinquance, la drogue et les sectes, pensez à la famille légitime plus qu’à la police, à la justice et à la prison. Mais plutôt que de renoncer à ses utopies, l’Etat totalitaire préfère épuiser ses contribuables en augmentant les effectifs de la police et de la justice et en construisant des prisons de plus en plus nombreuses parce que de plus en plus nécessaires.
On ne peut mieux servir le Royaume de France qu’en lui donnant des familles fécondes selon l’ordre naturel et chrétien, en dehors donc du capharnaüm législatif de l’Etat révolutionnaire.
C'est « l’expérience de la tradition » qui s’impose encore dans ce domaine.
22:03 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : famille chrétienne, tradition, révolution
14/12/2009
LA RÉVOLUTION EST UNE DOCTRINE

Mgr Freppel va droit à l'essentiel, d'emblée, en montrant dans la Révolution française non pas une simple péripétie de l'histoire mais une doctrine :
« Il en est, à certains égards, de la Révolution française comme de la Réforme protestante du seizième siècle : l'une et l'autre constituent un mouvement d'idées qui dépasse de loin les limites d'un siècle ou d'un pays. Si tout s'était borné en 1789 et en 1793 à renverser une dynastie, à substituer une forme de gouvernement à une autre, il n'y aurait eu là qu'une de ces catastrophes dont l'histoire nous offre maint exemple. Mais la Révolution française a un tout autre caractère : elle est une doctrine, ou, si l'on aime mieux, un ensemble de doctrines, en matière religieuse, philosophique, politique et sociale. Voilà ce qui lui donne sa véritable portée ; et c'est à ces divers points de vue qu'il convient de se placer, pour la juger en elle-même et dans son influence sur les destinées de la nation française, comme aussi sur la marche générale de la civilisation. »
Car personne n'échappe à la contrainte de ces idées nouvelles qui mènent le monde : « Il est évident que pour chacun de nos contemporains la manière de voir et d'agir dépend, en grande partie, de l'idée qu'il se fait du mouvement de 1789, point de départ de l'époque actuelle. (...) »
Déjà, la conclusion se laisse deviner : « Telle est la question qu'il importe de résoudre, à la veille du centenaire de 1789, pour savoir si, loin de pouvoir être considérée comme un bienfait, la Révolution française n'est pas l'un des événements les plus funestes qui aient marqué l'histoire du genre humain. »
RÉFORMES ET RÉVOLUTION
« Le mouvement de 1789 devait être, selon le désir général, un mouvement réformateur, et il est devenu un mouvement révolutionnaire. C'est à la fois son vice et sa condamnation » explique Mgr Freppel. (...)
« Une nation, rompant brusquement avec tout son passé, faisant, à un moment donné, table rase de son gouvernement, de ses lois, de ses institutions, pour rebâtir à neuf l'édifice social, depuis la base jusqu'au sommet, sans tenir compte d'aucun droit ni d'aucune tradition ; une nation réputée la première de toutes, et venant déclarer à la face du monde entier qu'elle a fait fausse route depuis douze siècles, qu'elle s'est trompée constamment sur son génie, sur sa mission, sur ses devoirs, qu'il n'y a rien de juste ni de légitime dans ce qui a fait sa grandeur et sa gloire, que tout est à recommencer et qu'elle n'aura ni trêve ni repos tant qu'il restera debout un vestige de son histoire : non, jamais spectacle aussi étrange ne s'était offert aux regards des hommes. » (...)
La Révolution française est « une doctrine radicale, une doctrine qui est l'antithèse absolue du christianisme, de là sa fausseté manifeste, comme aussi l'importance de son rôle et de son action dans l'histoire du genre humain. »
UNE RÉVOLUTION ANTICHRÉTIENNE
« La Révolution française, écrit Mgr Freppel, est l'application du rationalisme à l'ordre civil, politique et social : voilà son caractère doctrinal, le trait qui la distingue de tous les autres changements survenus dans l'histoire des États. Ce serait s'arrêter à la surface des choses, que d'y voir une simple question de dynastie, ou de forme de gouvernement, de droits à étendre ou à restreindre pour telle ou telle catégorie de citoyens. »
La vérité est qu'il y a là « toute une conception nouvelle de la société humaine envisagée dans son origine, dans sa constitution et dans ses fins ». Il ne s'agit pas d'une simple « attaque visant à la destruction de l'Église catholique ». La Révolution veut « dans son principe comme son but, l'élimination du christianisme tout entier, de la révélation divine et de l'ordre surnaturel, pour s'en tenir uniquement à ce que ses théoriciens appellent les données de la nature et de la raison. Lisez la Déclaration des droits de l'homme, on dirait que pour cette nation chrétienne depuis quatorze siècles, le christianisme n'a jamais existé ou qu'il n'y a pas lieu d'en tenir le moindre compte. »
Et Mgr Freppel de conclure avec flamme : « C'est le règne social de Jésus-Christ qu'il s'agit de détruire et d'effacer jusqu'au moindre vestige. La Révolution, c'est la société déchristianisée ; c'est le Christ refoulé au fond de la conscience individuelle, banni de tout ce qui est public, de tout ce qui est social ; banni de l'État, qui ne cherche plus dans son autorité la consécration de la sienne propre ; banni des lois, dont sa loi n'est plus la règle souveraine ; banni de la famille, constituée en dehors de sa bénédiction ; banni de l'école, où son enseignement n'est plus l'âme de l'éducation ; banni de la science, où il n'obtient plus pour tout hommage qu'une sorte de neutralité non moins injurieuse que la contradiction ; banni de partout, si ce n'est peut-être d'un coin de l'âme où l'on consent à lui laisser un reste de domination. (...) »
Ce n'est plus en Dieu que l'on cherche « le principe et la source de l'autorité, mais dans l'homme, et dans l'homme seul. La loi n'est plus que l'expression de la volonté générale, d'une collectivité d'hommes qui décident en dernier ressort et sans recours possible à aucune autre autorité, de ce qui est juste ou injuste. Tout est livré à l'arbitraire et au caprice d'une majorité. (...) Peu importe, par conséquent, qu'on laisse le nom de l'Être suprême au frontispice de l'œuvre comme un décor ou un trompe-l'œil ; en réalité, l'homme a pris la place de Dieu, et la conséquence logique de tout le système est l'athéisme politique et social. (...)
22:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mgr freppel, révolution
20/07/2009
Les dessous de la Bastille

Glorieuse, la prise de la Bastille ? Pas tant que ça... D’ailleurs, le 14 juillet n’a été choisi comme fête nationale qu’environ cent ans plus tard, en 1880, et la date a été largement discutée : les députés et les sénateurs ont proposé aussi bien le 4 août que le 5 mai que le 21 septembre, etc. et le 14 juillet ne l’emporte que de peu.
La Bastille : du mythe à la réalité
« Le matin fut lumineux et d’une sérénité terrible, écrira Michelet : Une idée se leva sur Paris avec le jour, et tous virent la même lumière. Une lumière dans les esprits et dans chaque cœur une voix : Va et tu prendras la Bastille ! ».
La prise de la Bastille est devenue dans les livres scolaires de la IIIe République le symbole de la victoire du peuple sur la « tyrannie ». En effet, chacun comprendra qu’il est toujours dans l’intérêt de ceux qui ont pris le pouvoir en 1789 de masquer leur propre violence et l’arbitraire sur lesquels ils ont assis leur domination. Se fabriquant ainsi leurs propres mythes fondateurs…
La Bastille : sa réalité à la veille du 14 juillet
En 1789, il y avait déjà longtemps que la Bastille ne servait plus guère. On envisageait même de supprimer cette forteresse trop coûteuse.
Quand la Bastille est prise le 14 juillet, elle ne détient dans ses geôles que sept prisonniers : des fous, un faussaire et quelques personnes si peu recommandables qu’il est bien difficile de se glorifier de leur libération. Sept détenus c’était vraiment peu… Michel Winoch le déplorait, en ajoutant que la réalité n’a pas besoin de coïncider avec les idées reçues, les faux bruits ou les imaginations. De plus à la fin du XVIIIème siècle, le traitement des prisonniers à la Bastille était décent, mais pour légitimer l’émeute, les révolutionnaires voulaient faire de la Bastille un engin de torture horrifique et injuste…
Le 14 juillet : on marche d’abord sur les Invalides, pas sur la Bastille
Au matin du 14 juillet, les émeutiers se dirigent vers les invalides. Ils exigent des armes demandées la veille, et comme le gouverneur, Sombreuil, avait voulu négocier, ils profitent de l’ouverture de la porte pour s’engouffrer et piller les fusils qui se trouvaient là, des canons et un mortier.
Et voilà donc les émeutiers en marche vers la forteresse.
Sur place, le dérapage...

Les émeutiers n’avaient pas rencontré d’opposition aux Invalides. Mais, à la Bastille, le gouverneur, Bernard de Launay, s’affole en voyant la foule approcher. Ses ordres sont contradictoires. Il envisage même de faire sauter le stock de poudre pour éviter qu’on ne s’en empare. Puis il tente de négocier. Enfin finalement, il laisse entrer les émeutiers dans les cours de la forteresse…
L’épisode qui suit est tristement célèbre : Launay est entrainé vers l’Hôtel de ville, harcelé de coups, finalement massacré au sabre. Sa tête, coupée au couteau par l’aide-cuisinier Desnot, est promené au bout d’un pique dans tout Paris, bientôt accompagné du prévôt des marchands. Flesselles, que l’on assassina dans la foulée. On but le sang des malheureuses victimes : « Acte d’un goût douteux, conclut le professeur Jean Tulard, mais qui va se généraliser durant les années suivantes et de devenir une forme de « civilité » révolutionnaire pour les victimes de marque ».
CONCLUSION :
La conclusion qu’inspire ce récit, pourtant résumé des événements est que, contrairement à une légende tenace, la Bastille n’a pas été prise d’assaut, mais elle s’est rendue. Autrefois les livres scolaires, aujourd’hui les encyclopédies ont diffusé et diffusent encore abondamment les images fortes d’un peuple vigoureux et courageux, faisant tomber par la seule force de son ardeur, l’une des plus puissantes forteresses médiévales. Et ainsi, de pierre en pierre, va se construire une nouvelle Bastille celle du « mythe ».
FETERA-T-ON LE TRICENTENAIRE DE LA REVOLUTION ?
Contester le mythe révolutionnaire, comme s’y emploient les historiens actuels, délégitimer la Terreur, c’est ruiner le présupposé ancien selon lequel les progrès sociaux s’obtiendraient par la violence. Conduite au nom du peuple, la Révolution s’est effectuée sans le consentement du peuple, et souvent même contre le peuple. Le bicentenaire n’a pas vraiment commémoré 1789, mais plutôt exalté l’idée que la France de 1989, du moins celle qui est au pouvoir, se fait d’elle-même…
Quittons l’histoire pour le champ de la prospective. Au rythme ou vont les choses… Que réserve 2089 ? Si la logique communautariste qui prévaut aujourd’hui n’a pas été renversée. Et que les Musulmans seront devenus majoritaire dans le pays. Pouvons sérieusement imaginer un seul instant ces nouveaux « Musulmans de France » célébrer 1789 ? Quant on sait que la pensée révolutionnaire ne s’accorde pas avec l’anthropologie exprimée par les textes sacrés de l’islam. Quelle signification pourrait revêtir pour eux en 2089 la commémoration de la révolution « française » ?
L’histoire n’étant jamais écrite d’avance, et l’histoire de France ayant toujours réservé d’étonnantes et miraculeuses surprises. On ne peut s’empêcher d’imaginer, et d’espérer voir sur notre sol un retour en force de la Foi catholique. Certes il faudrait alors tout reconstruire, ces nouveaux chrétiens auront certainement donc d’autres urgences que de célébrer ou de contester le tricentenaire de 1789…
(Article proposé par Madame Charlène Courtois).
22:13 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bastille, launay, terreur, révolution
07/06/2009
Regard sur notre époque.
Au moment ou notre pays s’enfonce chaque jour davantage dans le marasme économique et social, au moment ou la France trébuche dans l’anarchie, les vieux démons reprennent vie. Les mythes destructeurs de la nation, à l’instar de la lutte des classes, servent de justification à la révolte et à la violence urbaine. Certains leaders politiques de la gauche extrême y puisent une sorte de brevet révolutionnaire, une identification avec les « grands ancêtres » de la révolution de 1789. L’hostilité viscérale à l’entreprise et à l’autorité reste une constante idéologique de l’opinion publique.
Notre pays est miné par la montée continue des différentes formes d’insécurité. Le poids du communautarisme, l’effacement des repères identitaires et des valeurs morales qui ont structurés jadis notre civilisation en étant les principaux facteurs. La France subit une montée progressive de la violence, elle est le théâtre de nombreux affrontements brutaux, au relent de guerre civile. Ce processus funeste apporte la preuve irréfutable de l’inaptitude constante des Français (de la majorité) à régler par le dialogue démocratique les difficultés rencontrées au niveau de la Cité. Aujourd’hui chez nous, chaque débat, chaque négociation républicaine tourne à la querelle idéologique et engendre une contestation permanente…
Tout pousse à la rupture. L’immense mérite de nos Rois chrétiens a consisté, siècle après siècle, crise après crise, à panser les plaies, à atténuer les souffrances humaines, à apaiser les passions, à maintenir l’unité, à servir le bien commun. Quel contraste éclatant !
Alors aujourd’hui, il semble en effet que cette remise en ordre de manière durable, ne soit pas possible. L’autorité légitime ayant disparu, depuis plus de deux cents ans quelque chose est brisé, et notre beau pays dégringole allant de rupture en rupture. Cela tient tout d’abord au fait que Dieu a été chassé avec violence de nos institutions et de nos âmes. Il est désormais interdit de prononcer son nom dans une enceinte publique. De nombreuses conséquences découlent de cette apostasie. Et notamment cette faillite prévisible de l’éducation nationale.
La médiocrité et l’inadaptation des institutions actuelles ne sont plus à démontrer. Les esprits les plus éclairés savent bien que les institutions républicaines sont parfaitement incapables de discerner ou de servir le bien commun.
Et puis… n’oublions pas non plus, la façon dont on manipule l’opinion afin qu’elle se plie aux exigences de telle ou telle minorité agissante. Les partis politiques jouent un rôle déterminant dans la désintégration de la vie nationale. Ils se manifestent, à l’évidence, comme des ferments de division et des révélateurs des plus médiocres ambitions. Leur raison d’être essentielle se limite le plus souvent à la conquête où à la conservation d’un pouvoir éphémère. Un parti est d’abord, une machine électorale à la recherche permanente de candidats et de colleurs d’affiches... Le système oblige les éventuels candidats de bonne volonté à dissimuler leur véritable opinion, à ruser, à mentir, puis finalement à trahir ceux qui ont naïvement fait confiance. Il semble que la démagogie engendrée par le suffrage universel a encore de beaux jours devant elle, à moins que…. cette société, à bout de souffle ne s’effondre sur elle-même.
Si Dieu voulait bien prendre en pitié le « Royaume des Lys », il pourrait une fois encore, permettre que l’héritier de nos Rois renoue le fil brisé de notre histoire. D’aucuns penseront qu’il est bien tard, les choses étant trop avancées. Peut être bien… mais ce n’est pas en vain que la « providence » a donné l’espérance comme devise à la Maison de Bourbon. C’est donc à un long travail nécessaire de reconstruction que nous sommes conviés après ces 220 années de désordre croissant. Sans doute cette tâche dépasse nos pauvres forces humaines mais Dieu viendra à notre aide si nous acceptons, selon la parole de Saint Pie X de « tout restaurer dans le Christ ». Alors les individus et les nations reprendront le chemin de la conversion, la chrétienté rayonnera à nouveau sur l’occident et le Roi de France reviendra...
MARQUIS DES CHOUANS.

21:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chouan, royauté, révolution, élections
30/05/2009
Les dernières heures de Sa Majesté le Roy Louis XVI.
 Le 20 janvier, le ministre de la Justice Garat vint signifier au Roy le décret qui le condamnait à mort. Le secrétaire du Conseil exécutif Grouvelle, chevrotant, lut la sentence. Le Roy l'écouta sans un mot. Il remit à Garat une lettre demandant un délai de trois jours pour se préparer à la mort, l'autorisation de revoir sa famille et d'appeler auprès de lui un prêtre de son choix. Pour ce ministère, il désignait l'abbé Henri Essex Edgeworth de Firmont. La Convention rejeta le délai, mais accorda les autres demandes. Le décret proposé par Cambacérès portait que «la nation française, aussi grande dans sa bienfaisance que rigoureuse dans sa justice, prendra soin de la famille du condamné et lui fera un sort convenable»
Le 20 janvier, le ministre de la Justice Garat vint signifier au Roy le décret qui le condamnait à mort. Le secrétaire du Conseil exécutif Grouvelle, chevrotant, lut la sentence. Le Roy l'écouta sans un mot. Il remit à Garat une lettre demandant un délai de trois jours pour se préparer à la mort, l'autorisation de revoir sa famille et d'appeler auprès de lui un prêtre de son choix. Pour ce ministère, il désignait l'abbé Henri Essex Edgeworth de Firmont. La Convention rejeta le délai, mais accorda les autres demandes. Le décret proposé par Cambacérès portait que «la nation française, aussi grande dans sa bienfaisance que rigoureuse dans sa justice, prendra soin de la famille du condamné et lui fera un sort convenable»
Ce « sort convenable », on le connaît…
Garat fit donc prévenir l'abbé Edgeworth et le ramena lui-même au Temple dans sa voiture. Le prêtre voulut échanger son habit bourgeois contre un costume ecclésiastique, mais Garat lui dit:
- C'est inutile, d'ailleurs le temps nous presse.
Le 20 janvier à six heures du soir, le confesseur entra chez le Roy. Tous les assistants s'étant écartés, ils restèrent seuls. Louis XVI parla un moment avec l'abbé et lui lut son testament. Puis il le pria de passer dans le cabinet voisin pour lui permettre de recevoir sa famille.
La porte s'ouvrit et la Reine entra, tenant son fils par la main ; derrière venaient Madame Elisabeth et Madame Royale. Tous pleuraient. Ils ne savaient rien de précis encore, mais ils craignaient le pire. Le Roy s'assit, entouré de son épouse et de sa soeur. Sa fille était en face de lui et il tenait l'enfant entre ses genoux. Avec de tendres ménagements, à voix basse, il les avertit. Par la porte vitrée, Cléry les vit s'étreindre en sanglotant.
Tenant ses mains dans les siennes, Louis XVI fit jurer à son fils de ne jamais songer à venger sa mort. Il le bénit et bénit sa fille. Par instants, il gardait le silence et mêlait ses larmes aux leurs. Cette scène poignante se prolongea plus d'une heure et demie… A la fin, quel que soit son courage, il n'en put plus. Il se leva et conduisit sa famille vers la porte. Comme ils voulaient rester encore et s'attachaient à lui en gémissant, il dit:
- Je vous assure que je vous verrai demain matin à huit heures.
- Vous nous le promettez? supplièrent-ils ensemble.
- Oui, je vous le promets.
- Pourquoi pas à sept heures? dit la Reine.
- Eh bien oui, à sept heures… Adieu.
Malgré lui, cet adieu rendit un son tel que les malheureux ne purent étouffer leurs cris. Madame Royale tomba évanouie aux pieds de son père. Cléry et Madame Elisabeth la relevèrent. Le Roy les embrassa tous encore, et doucement les poussa hors de sa chambre.
- Adieu, adieu, répétait-il, avec un geste navrant de la main.
Il rejoignit l'abbé Edgeworth dans le petit cabinet pratiqué dans la tourelle.
- Hélas, murmura-t-il, il faut que j 'aime et sois tendrement aimé!
Sa fermeté revenue, il s'entretint avec le prêtre. Jusqu'à minuit et demi, le Roy demeura avec son confesseur. Puis il se coucha. Cléry voulut lui rouler les cheveux comme d'habitude.
- Ce n'est pas la peine, dit Louis XVI.
Quand le valet de chambre ferma les rideaux, il ajouta : « Cléry, vous m'éveillerez demain à cinq heures.» Et il s'endormit d'un profond sommeil.
21 janvier 1793 :
A cinq heures, Cléry allume le feu. Au peu de bruit qu'il fait, Louis XVI ouvre les yeux, tire son rideau :
- Cinq heures sont-elles sonnées?
- Sire, elles le sont à plusieurs horloges, mais pas encore à la pendule.
- J'ai bien dormi, dit le Roy, j'en avais besoin, la journée d'hier m'avait fatigué. Où est Monsieur de Firmont?
- Sur mon lit.
- Et vous? où avez-vous dormi?
- Sur cette chaise.
- J'en suis fâché, murmure Louis XVI, soucieux toujours du bien-être de ses serviteurs.
- Ah, Sire, dit Cléry en lui baisant la main, puis-je penser à moi dans ce moment?
Il habille et coiffe son maître devant plusieurs municipaux qui, sans respect, sont entrés dans la chambre. Puis il transporte une commode au milieu de la pièce pour servir d'autel. Revêtu de la chasuble, l'abbé commence la messe, que sert Cléry. Le Roy l'entend à genoux et reçoit la communion, il remercie ensuite le valet de chambre de ses soins et lui recommande son fils.
- Vous lui remettrez ce cachet, vous donnerez cet anneau à la Reine, dites-lui que je le quitte avec peine… Ce petit paquet contient des cheveux de toute ma famille, vous le lui remettrez aussi. Dites à la Reine, à mes chers enfants, à ma soeur, que je leur avais promis de les voir ce matin, mais que j 'ai voulu leur épargner la douleur d'une séparation nouvelle…
Essuyant ses larmes, il murmure alors:
- Je vous charge de leur faire mes adieux.
Il s'est approché du feu, y réchauffe ses mains froides. Il a demandé des ciseaux pour que Cléry lui coupe les cheveux au lieu du bourreau. Les municipaux, défiants, les refusent.
Dans l'aube triste de ce dimanche d'hiver, un grand bruit environne la Tour. Alertées par la Commune, toutes les troupes de Paris sont sous les armes. L'assassinat, la veille au soir, de Lepeletier de Saint-Fargeau, l'exalté Montagnard, tué d'un coup de sabre par l'ancien garde du corps Deparis, a fait redoubler les précautions militaires. Partout les tambours battent la générale. Les sections armées défilent dans les rues, les vitres résonnent du passage des canons sur les pavés. A huit heures Santerre arrive au Temple avec des commissaires de la Commune et des gendarmes. Nul ne se découvre.
- Vous venez me chercher? interroge le roi.
- Oui.
- Je vous demande une minute.
Il rentre dans son cabinet, s'y munit de son testament et le tend à un municipal qui se trouve être le prêtre défroqué Jacques Roux.
- Je vous prie de remettre ce papier à la Reine… Il se reprend, et dit: « à ma femme. »
- Cela ne me regarde point, répond Roux. Je ne suis pas ici pour faire vos commissions, mais pour vous conduire à l'échafaud.
- C'est juste, dit Louis XVI.
Un autre commissaire s'empare du testament qu'il remettra non à la Reine, mais à la Commune *.
Louis XVI est vêtu d'un habit brun, avec gilet blanc, culotte grise, bas de soie blancs. Cléry lui présente sa redingote.
- Je n'en ai pas besoin, donnez-moi seulement mon chapeau.
Il lui serre fortement la main, puis, regardant Santerre, dit :
- Partons!
D'un pas égal, il descend l'escalier de la prison. Dans la première cour, il se retourne et regarde à deux reprises l'étage où sont les siens : au double roulement qui a retenti lorsqu'il a franchi la porte de la Tour, ils se sont précipités vainement vers les fenêtres, obstruées par des abat-jour.
- C'en est fait, s'écrie la Reine, nous ne le verrons plus!
Le Roy monte dans sa voiture, un coupé vert, suivi de l'abbé Edgeworth de Firmont. Un lieutenant de gendarmerie et un maréchal des logis s'assoient en face d'eux sur la banquette de devant. Précédés de grenadiers en colonnes denses, de pièces d'artillerie, d'une centaine de tambours, les chevaux partent au pas… Les fenêtres, comme les boutiques, par ordre restent closes. Dans la voiture aux vitres embuées, Louis, XVI la tête baissée, lit sur le bréviaire du prêtre les prières des agonisants.
Vers dix heures, dans le jour brumeux, la voiture débouche enfin de la rue Royale sur la place de la Révolution. A droite en regardant la Seine, au milieu d'un espace encadré de canons et de cavaliers, non loin du piédestal vide qui supportait naguère la statue de Louis XV, se dresse la guillotine. La place entière est garnie de troupes. Les spectateurs ont été refoulés très loin. Il ne sort de leur multitude qu'un faible bruit, fait de milliers de halètements, de milliers de soupirs. Tout de suite, sur un ordre de Santerre, l'éclat assourdissant des tambours l'étouffe…
L'exécuteur Sanson et deux de ses aides, venus à la voiture, ouvrent la portière ; Louis XVI ne descend pas tout de suite ; il achève sa prière. Au bas de l'échafaud, les bourreaux veulent le dévêtir. Il les écarte assez rudement, ôte lui-même son habit et défait son col. Puis il s'agenouille aux pieds du prêtre et reçoit sa bénédiction. Les aides l'entourent et lui prennent les mains.
- Que voulez-vous? dit-il.
- Vous lier.
- Me lier, non, je n'y consentirai jamais!
Indigné par l'affront, son visage est soudain devenu très rouge. Les bourreaux semblent décidés à user de la force. Il regarde son confesseur comme pour lui demander conseil. L'abbé Edgeworth murmure:
- Faites ce sacrifice, Sire; ce nouvel outrage est un dernier trait de ressemblance entre Votre Majesté et le Dieu qui va être sa récompense.
- Faites ce que vous voudrez, je boirai le calice jusqu'à la lie.
On lui attache donc les poignets derrière le dos avec un mouchoir, on lui coupe les cheveux. Puis il monte le roide degré de l'échafaud, appuyé lourdement sur le bras du prêtre. A la dernière marche il se redresse et, marchant d'un pas rapide, il va jusqu'à l'extrémité de la plate-forme. Là, face aux Tuileries, témoins de ses dernières grandeurs et de sa chute, faisant un signe impérieux aux tambours qui, surpris, cessent de battre, il crie d'une voix tonnante :
- Français, je suis innocent, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que le sang qui va être répandu ne retombe jamais sur la France ! Et vous, peuple infortuné…
A cheval, Beaufranchet, adjudant général de Santerre, se précipite vers les tambours, leur jette un ordre. Un roulement brutal interrompt le Roy. Il frappe du pied l'échafaud :
- Silence, faites silence!
On ne l'entend plus. A quatre, les bourreaux se jettent sur lui, l'allongent sur la planche. Il se débat, pousse un cri… Le couperet tombe, faisant sauter la tête dans un double jet de sang qui rejaillit sur l'abbé Edgeworth. Sanson la prend et, la tenant par les cheveux, la montre au peuple. Des fédérés, des furieux escaladent l'échafaud et trempent leurs piques, leurs sabres, leurs mouchoirs, leurs mains dans le sang. Ils crient « Vive la nation! Vive la République! »
Quelques voix leur répondent. Mais le vrai peuple reste muet. Pour le disperser, il faudra longtemps… L'abbé descend de la plate-forme et fuit, l'esprit perdu. Une tradition lui a prêté ces mots, adressés au Roy comme adieu : “Fils de Saint Louis, montez au ciel!“
Source : Le Blog du Mesnil Marie
08:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis xvi, revolution, clery